MiCA et l’avenir des paiements : crypto-actifs, stablecoins et la reconfiguration de l’écosystème financier européen
17 août 2025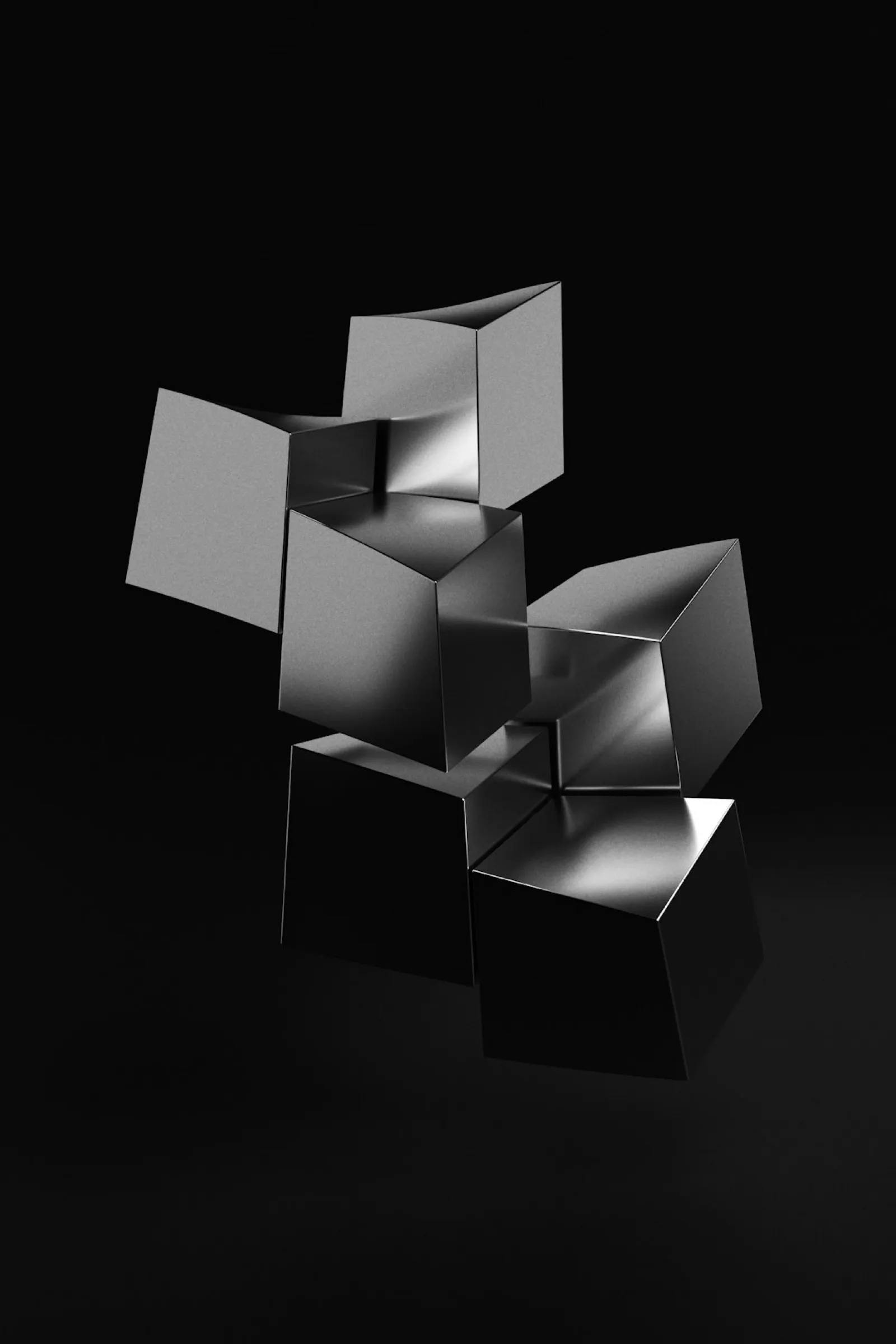
Introduction – La convergence des régulations et la mue du système monétaire européen
Depuis la crise financière de 2008, la stabilité des systèmes monétaires et financiers est redevenue un objet de souveraineté stratégique. À la faveur de cette reconfiguration post-crise, les crypto-actifs ont émergé comme une rupture à la fois technologique, monétaire et institutionnelle. Leur essor, d’abord marginal, a rapidement suscité un double mouvement : d’un côté, une adoption croissante par les marchés, notamment via les stablecoins, et de l’autre, une préoccupation croissante des régulateurs, confrontés à des architectures financières échappant aux cadres juridiques classiques.
Dans ce contexte, l’Union européenne s’est dotée en 2023 d’un corpus réglementaire pionnier : le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets). Pour la première fois, une puissance économique majeure définit un cadre normatif cohérent, applicable à l’ensemble des acteurs manipulant des crypto-actifs – émetteurs, fournisseurs de services, ou développeurs d’infrastructures décentralisées. Cette régulation dépasse la logique de rattrapage défensif : elle s’inscrit dans une ambition stratégique plus vaste de construction d’un espace numérique européen souverain, à la fois sûr pour les utilisateurs et compétitif pour l’innovation.
Dans le même temps, un second chantier de réforme est en cours, moins visible mais tout aussi structurant : la révision de la directive sur les services de paiement (PSD3) et la création de son corollaire réglementaire, le Payment Services Regulation (PSR). Ces textes visent à adapter le droit des paiements aux enjeux contemporains – cybersécurité, lutte contre la fraude, émergence de nouveaux modèles transactionnels – mais soulèvent une question centrale : comment articuler ce nouveau droit des paiements avec le régime des crypto-actifs tel que défini par MiCA ?
Cette tension réglementaire recoupe une transformation plus profonde : la redéfinition du périmètre même de ce qu’on entend par “paiement”. Les stablecoins, notamment les e-money tokens (EMTs), présentent des propriétés qui les rendent assimilables à de la monnaie électronique, tout en relevant d’une logique technologique fondamentalement différente. Faut-il les intégrer dans le giron des prestataires de services de paiement ? Créer une catégorie hybride ? Ou repenser le droit monétaire à l’aune de la finance programmable ?
L’objet de cet article est triple :
- Clarifier le périmètre et les fondements du règlement MiCA, en soulignant les enjeux spécifiques liés aux stablecoins.
- Analyser les dynamiques de marché que ces régulations sont susceptibles de déclencher, en particulier dans le secteur des paiements.
- Évaluer les interactions entre MiCA et la réforme PSD3/PSR, en identifiant les zones de friction, les risques d’arbitrage réglementaire, mais aussi les opportunités d’harmonisation.
À l’heure où la Banque centrale européenne expérimente l’euro numérique, et où les géants du Web3 déploient des solutions de paiement globalisées, la question n’est plus de savoir si les crypto-actifs redessineront les frontières de la monnaie et des services financiers, mais de sous quelle gouvernance, avec quels garde-fous, et au bénéfice de quelles parties prenantes.
Partie I – MiCA : fondements conceptuels et cadre normatif
1.1 Une régulation pionnière dans un vide juridique systémique
Avant MiCA, l’univers des crypto-actifs en Europe évoluait dans une zone grise juridique. Les crypto-actifs, à l’exception de ceux considérés comme instruments financiers au sens de MiFID II, échappaient à tout cadre réglementaire harmonisé au niveau de l’Union. Cette absence de régulation cohérente engendrait trois conséquences majeures : (i) un arbitrage réglementaire entre États membres, (ii) une asymétrie d’information pour les consommateurs, et (iii) un angle mort dans la surveillance des risques systémiques liés à certains tokens adossés à des actifs réels.
Le règlement MiCA, adopté en mai 2023 dans le cadre du Digital Finance Package, vise à combler ce vide. Il s’inscrit dans une logique doublement stratégique : garantir un haut niveau de protection des investisseurs, tout en consolidant la compétitivité du marché européen des crypto-actifs face aux grandes places extra-européennes (notamment les États-Unis et Singapour). À cet égard, MiCA ne se contente pas de poser des obligations de transparence : il crée un corpus de règles prudentielles, de conditions d’autorisation, de gouvernance, et de supervision à part entière.
1.2 Une architecture réglementaire fondée sur la typologie fonctionnelle des actifs
Le régime MiCA repose sur une typologie différenciée des crypto-actifs, fondée non pas sur leur technologie sous-jacente, mais sur leur finalité économique et leur lien éventuel avec des actifs de référence. Trois grandes catégories sont ainsi définies :
- Crypto-actifs généraux (other crypto-assets) : actifs numériques ne relevant d’aucune des deux catégories suivantes, comme les utility tokens. Leur régime repose principalement sur des exigences de publication de livre blanc, d’enregistrement du prestataire, et de respect des obligations de transparence.
- Jetons référencés à des actifs (ARTs) : tokens adossés à un panier d’actifs (monnaies fiat, matières premières, autres crypto-actifs). L’objectif de ce régime est de contrôler les risques de déstabilisation monétaire, en imposant des conditions de gouvernance et des exigences de transparence accrues.
Parmi eux, certains ARTs peuvent être désignés comme systémiques, en fonction de seuils et critères définis à l’article 43 du règlement. Cette qualification s’applique notamment si l’ART dépasse une valeur de marché de 5 milliards d’euros, ou touche plus de 10 millions d’utilisateurs actifs dans l’UE. D’autres facteurs tels que le volume de transactions, l’interconnexion avec d’autres systèmes financiers ou l’utilisation transfrontalière étendue sont également pris en compte. Dans ce cas, l’ART est soumis à un régime de supervision directe par l’EBA, à des obligations prudentielles renforcées, et peut, en dernier recours, faire l’objet d’une interdiction d’utilisation sur le territoire de l’Union en cas de menace à la stabilité financière.
- Jetons de monnaie électronique (EMTs) : tokens stabilisés sur une seule monnaie fiat, conçus pour des usages de paiement. Ils sont juridiquement assimilés à des monnaies électroniques, avec une articulation directe avec la directive EMD2. Les EMTs sont soumis à un régime prudentiel strict, proche de celui des établissements de monnaie électronique, avec une exigence de réserve intégrale et une limitation des services offerts.
Cette classification emporte des conséquences considérables sur les modèles économiques des émetteurs : elle conditionne non seulement la charge réglementaire, mais aussi le type de licence requis, la nature des garanties à fournir aux utilisateurs, et le champ d’activité permis.
1.3 Conditions d’entrée sur le marché : autorisation, supervision, responsabilité
Le régime MiCA impose un ensemble d’obligations structurantes pour les émetteurs de jetons et les fournisseurs de services sur crypto-actifs (CASPs) :
- Obligation d’autorisation préalable pour les émetteurs d’ARTs et d’EMTs, avec un agrément délivré par l’autorité nationale compétente, dans un cadre harmonisé au niveau de l’Union. Les petits émetteurs de crypto-actifs généraux bénéficient d’un régime allégé.
- Régime de passeport européen : une fois agréé dans un État membre, un émetteur ou prestataire peut opérer dans toute l’UE, à l’instar des règles en matière bancaire ou assurantielle.
- Encadrement des CASPs : les plateformes d’échange, de conservation, d’exécution d’ordres ou de conseil sur crypto-actifs sont soumises à un régime similaire à celui des prestataires de services financiers, avec des exigences de fonds propres, de séparation des actifs clients, et de dispositifs de contrôle internes.
- Responsabilité du livre blanc : le document d’information publié par l’émetteur est contraignant sur le plan juridique. Toute omission ou inexactitude peut donner lieu à un recours en responsabilité, renforçant ainsi l’obligation de transparence.
L’ensemble de ces obligations vise à transposer dans l’univers crypto les piliers fondamentaux de la régulation financière traditionnelle : asymétrie d’information, intégrité des marchés, et protection des investisseurs.
1.4 Gouvernance institutionnelle : articulation avec les régimes sectoriels
MiCA ne fonctionne pas en silo. Il s’articule étroitement avec les autres textes sectoriels du droit financier européen :
- Les EMTs, en tant que monnaies électroniques, doivent s’inscrire dans le cadre de la directive EMD2, ce qui implique des règles supplémentaires sur la ségrégation des fonds et la relation client.
- Les ARTs à dimension systémique sont placés sous la supervision directe de l’Autorité bancaire européenne (EBA), tandis que les émetteurs non systémiques restent supervisés par les autorités nationales. Cette répartition vise à concentrer les ressources de supervision sur les tokens à risque systémique.
- MiCA prévoit des interactions avec le DLT Pilot Regime, qui permet l’expérimentation de plateformes de négociation basées sur la blockchain pour les instruments financiers traditionnels. Cette complémentarité témoigne d’un mouvement plus vaste vers une infrastructure financière tokenisée.
En somme, MiCA n’est pas une simple régulation sectorielle : il constitue une brique structurante dans la stratégie européenne de transformation de la finance numérique, en intégrant les logiques de supervision financière, de souveraineté numérique, et de standardisation réglementaire.
Partie II – Les stablecoins comme objets monétaires hybrides : entre stabilité transactionnelle et risque systémique
2.1 Une catégorie émergente aux frontières de la monnaie
Dans l’économie numérique, les stablecoins ont émergé comme une réponse au dilemme fondamental des crypto-actifs : leur extrême volatilité, qui limite leur usage transactionnel. En se rattachant à une valeur de référence stable, les stablecoins ambitionnent de devenir des instruments de règlement viables, aussi bien dans les échanges pair-à-pair que dans les paiements transfrontaliers, les règlements instantanés ou les smart contracts.
Mais ce projet de stabilité ne fait pas des stablecoins des objets monétaires ordinaires. Ils sont porteurs d’une ambivalence structurelle :
- D’un point de vue fonctionnel, ils remplissent des fonctions monétaires classiques (unité de compte, intermédiaire d’échange, réserve de valeur) mais en dehors du circuit de création monétaire centralisé.
- D’un point de vue juridique, ils oscillent entre actifs financiers, instruments de paiement et contrats numériques, rendant leur classification instable.
Leur expansion rapide – à l’instar de USDT (Tether) ou USDC (Circle) – a démontré leur capacité à devenir des infrastructures de marché alternatives, voire des substituts privés à la monnaie émise par l’État. Cette trajectoire soulève un défi de fond pour les banques centrales : quelle place accorder à des formes de monnaie privée dans un système monétaire souverain ?
2.2 MiCA : une réponse différenciée à la pluralité des modèles
Conscient de cette hybridité, MiCA segmente les stablecoins en deux catégories distinctes, dotées de régimes spécifiques :
a. Les jetons de monnaie électronique (EMTs)
Les EMTs sont des tokens adossés à une seule monnaie fiduciaire (ex. : 1 EMT = 1 EUR), dont la finalité est transactionnelle. Leur modèle est très proche de celui de la monnaie électronique telle que définie dans la directive EMD2.
MiCA les encadre par un régime rigoureux :
- Réserve à 100 % libellée dans la devise de référence, conservée auprès d’établissements de crédit ou d’autres entités sécurisées.
- Droit au remboursement à tout moment pour les détenteurs.
- Interdiction de rémunération sur la détention des jetons, afin d’éviter les effets de désintermédiation bancaire.
- Licence obligatoire en tant qu’établissement de monnaie électronique ou de crédit.
L’objectif est clair : favoriser l’usage transactionnel sans fragiliser le système monétaire ou bancaire, en limitant tout effet de levier ou de transformation de maturité.
b. Les jetons référencés à des actifs (ARTs)
Les ARTs reposent sur un panier d’actifs (monnaies fiat, matières premières, crypto-actifs). Leur stabilité est relative, leur gouvernance souvent opaque, et leur usage susceptible de générer des effets de substitution monétaire, en particulier dans les juridictions à faible stabilité monétaire.
Leur régime comporte :
- Conditions de publication d’un white paper détaillé, incluant les modalités de stabilisation et les droits des porteurs.
- Mécanismes de gouvernance renforcés, incluant des comités de gestion des actifs de réserve.
- Régime de surveillance adapté à leur dimension systémique, avec un encadrement direct par l’EBA si certaines conditions de seuil sont dépassées (volume d’émission, nombre d’utilisateurs, interconnexion avec les systèmes de paiement).
En cas de risque systémique avéré, la Commission européenne peut activer une interdiction d’émission ou d’utilisation sur le territoire de l’Union – une disposition sans précédent en matière de régulation monétaire.
2.3 Risques structurels associés aux stablecoins
Le régime prudentiel différencié de MiCA traduit une lecture fine des risques spécifiques liés aux stablecoins :
- Risque de réserve : la stabilité d’un stablecoin dépend de la qualité, de la liquidité et de la gouvernance des actifs de réserve. Toute opacité ou transformation de maturité introduit un risque de bank run numérique.
- Risque opérationnel et technologique : les mécanismes d’émission, de destruction, de stabilisation ou d’interopérabilité sont codés dans des smart contracts souvent non audités, vulnérables aux failles.
- Risque de fragmentation monétaire : à mesure que les stablecoins s’intègrent dans les chaînes de valeur (paiements, DeFi, métavers, e-commerce), ils peuvent devenir des monnaies de fait, concurrentes de l’euro, en particulier si libellés en USD.
- Risque réglementaire extraterritorial : la dominance de stablecoins émis hors UE (comme USDT ou USDC) expose l’Europe à une dépendance à des régimes juridiques tiers, avec des conséquences sur la souveraineté monétaire.
2.4 Vers un modèle d’émission institutionnelle : la montée en puissance des EMTs européens
Dans ce paysage, une opportunité stratégique se dessine pour les acteurs régulés européens : émettre des EMTs en euros, conformes à MiCA, afin de construire une infrastructure monétaire programmable endogène.
Plusieurs scénarios sont envisageables :
- Les banques pourraient devenir émettrices d’EMTs, créant une nouvelle catégorie de monnaie scripturale programmable.
- Les PSP ou établissements de monnaie électronique pourraient émettre des stablecoins comme alternative aux virements ou cartes.
- Les entités publiques pourraient s’appuyer sur ce canal pour distribuer de manière ciblée des aides ou subventions (paiements conditionnels, automatisés, etc.).
Ce modèle, à mi-chemin entre innovation et rigueur prudentielle, pourrait positionner l’Europe à l’avant-garde de la finance programmable régulée.
Partie III – Reconfiguration du marché des paiements : vers une infrastructure tokenisée et programmable
3.1 Mutation des chaînes de valeur : de la monnaie électronique aux paiements tokenisés
Le secteur des paiements connaît depuis deux décennies une transformation profonde, marquée par la numérisation des canaux, la standardisation des protocoles (SEPA, ISO 20022), et l’essor de l’open banking. À cette dynamique s’ajoute désormais une mutation de nature infrastructurelle : l’émergence des stablecoins, en particulier des EMTs sous MiCA, introduit un nouveau paradigme transactionnel, fondé sur la tokenisation des unités de valeur.
Ce changement ne concerne pas uniquement le moyen de paiement : il recompose l’ensemble des couches du système de paiement, de la liquidité à la compensation, en passant par le stockage de valeur, l’authentification, et l’exécution conditionnelle (programmabilité).
Trois ruptures majeures doivent être soulignées :
- Désintermédiation technique : le règlement et le transfert peuvent s’opérer sur des registres distribués, sans recours aux systèmes de compensation centralisés (Target2, STEP2).
- Programmabilité native : via les smart contracts, les tokens peuvent intégrer des règles logiques automatisées (déblocage conditionnel, escrow, pénalité, etc.).
- Interopérabilité potentielle : les stablecoins conformes à MiCA peuvent être intégrés dans des écosystèmes blockchain transnationaux, réduisant le coût marginal des paiements transfrontaliers.
Ces dynamiques obligent les acteurs traditionnels – banques, établissements de monnaie électronique, prestataires de services de paiement – à repenser leur rôle dans la chaîne de valeur : sont-ils encore des fournisseurs d’infrastructures, des garants de confiance, des orchestrateurs d’expérience client, ou des émetteurs d’actifs numériques eux-mêmes ?
3.2 Émergence de cas d’usage concrets dans les paiements
Au-delà des effets théoriques, les cas d’usage de stablecoins dans les paiements commencent à se matérialiser, tant dans l’économie institutionnelle que dans les modèles émergents.
a. Paiements transfrontaliers B2B
Les virements internationaux restent coûteux, fragmentés et lents. Plusieurs acteurs, notamment fintechs et entreprises du commerce international, explorent les stablecoins en tant que vecteurs de liquidité intra-groupe, ou comme canaux de règlement bilatéraux, en contournant les frictions bancaires classiques. L’émission d’EMTs adossés à l’euro pourrait ainsi accélérer les paiements cross-border tout en restant sous régulation européenne.
b. E-commerce et paiements intégrés
Les plateformes de e-commerce peuvent intégrer des stablecoins comme moyens de règlement natifs, avec des logiques de cashback, de fidélité ou de règlement instantané. Certaines expérimentations reposent sur des stablecoins adossés à l’euro (ex. : agEUR, EURT) pour garantir la stabilité de la valeur tout en profitant de la finalité quasi-instantanée.
c. Trésorerie programmable pour entreprises
Des entreprises explorent l’usage de stablecoins pour la gestion automatisée de leur trésorerie, avec des cas d’usage comme le règlement automatique des fournisseurs, la distribution de dividendes, ou la mise en réserve conditionnelle de fonds (paiements à terme, dépôts de garantie, clauses contractuelles auto-exécutables).
d. Cas d’usages sectoriels à haute fréquence
Dans des verticales comme le gaming, les plateformes de freelancing ou l’économie des créateurs, les stablecoins permettent des paiements en temps réel, sans seuil ni coûts prohibitifs, à une échelle globale. Cette granularité ouvre la voie à de nouveaux modèles économiques fondés sur le micro-paiement et l’usage modulaire des services.
3.3 Repositionnement stratégique des acteurs traditionnels
Le cadre MiCA crée un espace réglementaire clair pour les prestataires traditionnels souhaitant intégrer les crypto-actifs à leur offre. Plusieurs options stratégiques se dessinent :
- Devenir émetteur d’EMTs : pour les établissements de monnaie électronique ou les banques, l’émission d’un stablecoin adossé à l’euro devient une option réaliste, à condition d’en maîtriser la technologie sous-jacente (custody, on-chain governance) et le modèle de distribution.
- Proposer des services de conservation ou d’échange de crypto-actifs (régime CASP) : un PSP pourrait devenir un guichet unique offrant à la fois des services de paiement traditionnels et des services sur crypto-actifs, intégrés dans un même parcours client.
- S’intégrer aux nouvelles infrastructures tokenisées : certains prestataires peuvent choisir de ne pas émettre eux-mêmes mais de s’interfacer avec des systèmes DLT portés par des tiers régulés, en créant des connecteurs sécurisés entre leurs API et les blockchains publiques ou privées.
Ce repositionnement suppose cependant de réconcilier deux mondes : celui de la conformité réglementaire, de la supervision prudentielle et de la sécurité opérationnelle, avec celui de la technologie blockchain, fondée sur la transparence radicale, la désintermédiation et la logique open-source.
3.4 La réponse stratégique des banques centrales : vers un continuum euro numérique / EMTs ?
L’essor des EMTs régulés par MiCA soulève une question stratégique fondamentale : quelle articulation avec l’euro numérique, tel que conçu par la Banque centrale européenne ?
Les deux objets monétaires répondent à des logiques différentes :
- L’euro numérique est une forme de monnaie centrale, directement émise par l’Eurosystème, conçue pour garantir la continuité de l’ancrage monétaire public dans l’ère numérique.
- Les EMTs, bien qu’adossés à l’euro, sont émis par des entités privées et intégrés à des logiques de marché. Leur liquidité, leur stabilité et leur intégrité dépendent de la robustesse du cadre prudentiel et de la supervision des réserves.
Il est toutefois envisageable que l’euro numérique et les EMTs coexistent dans un même écosystème monétaire, à condition que :
- Des règles d’interopérabilité et de convertibilité immédiate soient mises en place entre les deux formats ;
- Les standards de sécurité, de confidentialité et de transparence convergent ;
- L’euro numérique puisse être utilisé comme réserve ou collatéral de référence pour sécuriser les EMTs, renforçant ainsi la résilience du système.
En somme, l’émergence d’un continuum programmable entre monnaies publiques et monnaies privées régulées est désormais techniquement possible, juridiquement balisé, et économiquement désirable – à condition que les autorités monétaires, les régulateurs et les opérateurs privés en partagent la gouvernance.
Partie IV – Vers une convergence MiCA – PSD3/PSR : tensions et alignements dans la fabrique du droit des paiements
4.1 Une architecture réglementaire en recomposition
La publication de MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) ne s’inscrit pas en rupture avec le droit existant des paiements, mais dans un mouvement de recomposition plus vaste. En parallèle de MiCA, la Commission européenne a engagé la révision de la directive sur les services de paiement (PSD2), en la scindant en deux instruments distincts :
- Une directive PSD3, recentrée sur les règles institutionnelles (agrément, gouvernance, supervision) ;
- Un règlement PSR, visant à harmoniser les droits et obligations applicables aux services de paiement dans l’ensemble de l’UE, avec effet direct.
Ce redécoupage poursuit un double objectif :
(i) uniformiser les pratiques de supervision et les conditions de concurrence, dans un marché où les modèles hybrides (fintechs, bigtechs, PSPs crypto-natifs) brouillent les lignes historiques ;
(ii) mettre à jour les obligations liées à la sécurité, à la lutte contre la fraude et à la gestion des données, dans un environnement marqué par l’open banking et l’émergence des actifs numériques.
Dans cette refonte, la question centrale devient : comment articuler les obligations issues de MiCA avec celles de PSD3/PSR, sans générer de contradictions ou de doublons réglementaires ?
4.2 Recoupements de périmètre : vers un chevauchement fonctionnel
MiCA et PSD3/PSR couvrent des domaines en apparence distincts – les actifs numériques d’un côté, les services de paiement traditionnels de l’autre – mais en pratique, leurs périmètres fonctionnels convergent.
Plusieurs situations illustrent cette superposition :
- Un EMT adossé à l’euro peut être juridiquement considéré à la fois comme une monnaie électronique (sous EMD2) et comme un instrument de paiement (sous PSD3), avec des implications sur la supervision, le reporting, la gestion des réclamations ou les mécanismes de remboursement.
- Un prestataire de services sur crypto-actifs (CASP) peut proposer des services équivalents à ceux d’un PSP de type 1 ou 2, comme l’initiation de paiements, la garde de fonds, ou le change entre crypto-actifs et fiat.
- Certains services – comme les paiements conditionnels via smart contract, les portefeuilles auto-gérés, ou les ponts inter-chaînes (bridges) – n’entrent dans aucune catégorie existante, mais génèrent des effets économiques équivalents à ceux des paiements électroniques.
Ce chevauchement soulève plusieurs enjeux :
- Double régulation potentielle d’un même acteur selon qu’il opère en euro scriptural ou en EMT tokenisé ;
- Risque d’arbitrage réglementaire : des acteurs pourraient choisir le régime le moins contraignant selon leur interprétation des textes ;
- Incertitude juridique sur le traitement des services hybrides, au croisement entre paiement, crypto-actifs et traitement des données.
4.3 Harmonisation des exigences LCB-FT, cybersécurité et droits des utilisateurs
L’un des objectifs explicites de la réforme PSD3/PSR est d’élever les standards de sécurité et de conformité, en alignant les obligations sur les risques émergents liés à la numérisation des paiements et à l’usage des actifs numériques.
Sur le plan de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), la convergence est en cours :
- MiCA impose aux CASPs des obligations analogues à celles des PSPs, en lien avec le règlement TFR (Transfer of Funds Regulation), qui applique la Travel Rule aux crypto-actifs.
- PSD3 renforce les exigences en matière de vérification d’identité, de traçabilité des flux et de surveillance transactionnelle, y compris pour les acteurs exploitant des technologies DLT.
En matière de cybersécurité, PSD3 prévoit :
- Une extension du champ de la sécurité forte du client (SCA) ;
- Une meilleure gestion des incidents de sécurité, avec des obligations de notification et des mesures de remédiation obligatoires ;
- Un renforcement de la résilience opérationnelle, en lien avec le règlement DORA, applicable aussi aux CASPs jugés critiques.
Enfin, les deux cadres s’efforcent d’harmoniser les droits des utilisateurs finaux, notamment en ce qui concerne :
- Le droit au remboursement en cas d’opérations non autorisées ;
- La transparence des frais et des taux de change ;
- Les mécanismes de recours et la disponibilité d’un médiateur indépendant.
4.4 Scénarios de convergence ou de fragmentation
Deux scénarios se dessinent pour l’avenir de la régulation des paiements dans un monde crypto-intégré :
a. Scénario de convergence harmonisée
Dans ce scénario, les régulateurs adoptent une lecture fonctionnelle des textes, guidée par les effets économiques et les risques réels des services rendus. Les obligations sont alignées sur la base d’une logique de neutralité technologique, les processus de supervision sont mutualisés, et une passerelle réglementaire est mise en place entre les statuts de CASP et de PSP.
Cela permettrait :
- De faciliter l’entrée des acteurs crypto-régulés dans l’écosystème des paiements classiques ;
- De prévenir les arbitrages réglementaires ;
- De garantir la continuité de la protection des utilisateurs dans un contexte d’hybridation des services.
b. Scénario de fragmentation réglementaire
Dans ce cas, les régimes MiCA et PSD3/PSR évoluent en parallèle, sans articulation claire. Les prestataires sont contraints de cumuler les licences, les obligations et les contrôles, ce qui freine l’innovation, favorise les grandes entités multi-juridictionnelles, et augmente les barrières à l’entrée.
Le risque ici est double :
- Une complexification excessive du paysage réglementaire européen, décourageant l’entrée de nouveaux acteurs régulés ;
- Une perte de compétitivité face à des juridictions tierces plus agiles, où la convergence est déjà intégrée (ex. : Singapour, Royaume-Uni, Émirats arabes unis).
4.5 Vers un socle réglementaire intégré ?
Plusieurs voix s’élèvent déjà – au sein du Parlement européen, de l’EBA et de l’ESMA – pour réclamer une intégration progressive des régimes MiCA et PSD3/PSR. Cette dynamique pourrait prendre la forme :
- D’un paquet “Finance Numérique 2.0”, fusionnant les régimes à l’horizon 2027 ;
- D’un cadre de supervision coordonné, piloté par une autorité européenne unique ou un collège de superviseurs transverses ;
- D’une interopérabilité normative : modèles de livre blanc, passeports numériques, certificats de conformité, etc.
L’Union européenne dispose ici d’une opportunité historique : celle de concevoir une architecture réglementaire modulaire, intégrée et technologiquement neutre, capable d’accompagner l’émergence d’une finance programmable, tout en consolidant la souveraineté monétaire, la protection des utilisateurs et la stabilité du système.
Conclusion – Vers une finance programmable, régulée et souveraine : repenser l’ordre monétaire européen
Le règlement MiCA, en articulant innovation technologique et exigences prudentielles, inaugure un changement de paradigme dans la régulation financière européenne. En introduisant un cadre juridique clair pour les crypto-actifs – et en particulier pour les stablecoins – l’Union européenne n’a pas seulement comblé un vide normatif : elle a posé les bases d’une reconstruction ordonnée du système monétaire à l’ère numérique.
Ce mouvement s’inscrit dans un moment stratégique, où la définition même de la « monnaie » devient contestée par des logiques techniques (blockchain), économiques (tokenisation), et géopolitiques (dollarisation des stablecoins, dépendance aux infrastructures non-européennes). Les stablecoins, et notamment les EMTs régulés, peuvent incarner une troisième voie entre monnaie centrale et innovation privée dérégulée, à condition que leur usage s’intègre dans une gouvernance robuste, transparente et interopérable.
Dans ce contexte, les réformes parallèles de PSD3/PSR et l’évolution des standards LCB-FT et cybersécurité doivent être interprétées non comme des textes isolés, mais comme les composantes d’un socle réglementaire unifié, susceptible de garantir la cohérence de l’écosystème financier dans un environnement tokenisé. L’enjeu ne réside pas uniquement dans la supervision des acteurs, mais dans la capacité de l’Europe à orchestrer une convergence intelligente entre les univers bancaires, numériques et cryptographiques.
À plus long terme, trois questions structurantes émergent pour la doctrine réglementaire, les décideurs publics et les institutions financières :
- Quelle articulation entre euro numérique, stablecoins régulés et monnaie scripturale ?
Faudra-t-il réserver à chaque forme un usage spécifique, ou imaginer un continuum interopérable sous contrôle public-privé ?
- Quel rôle pour les prestataires traditionnels dans un système de paiements décentralisé ?
Seront-ils les garants de confiance d’une infrastructure hybride, ou perdront-ils leur position centrale au profit de nouveaux entrants agiles et technologiques ?
- Comment assurer la résilience, la transparence et la conformité d’une finance programmable ?
Cela suppose de dépasser la logique de conformité procédurale pour construire une architecture de confiance algorithmique, auditable et explicable, au croisement de la régulation, de la cryptographie et du droit.
L’ambition de MiCA n’est donc pas simplement de réguler l’existant : elle est de préparer le terrain à un système financier programmable, régulé, et ancré dans les principes démocratiques européens. Pour les acteurs des paiements, des crypto-actifs et de la régulation, il ne s’agit plus de choisir entre statu quo et disruption, mais de maîtriser la complexité émergente, et de contribuer activement à la co-construction d’un nouvel ordre monétaire numérique.
⸻
Onebird est le 1er collectif des consultants et managers de transition spécialisés en Compliance.